Le confort estival - principes généraux
Protection solaire
Apports internes
Inertie thermique,
l'effet de la masse du bâtiment
Ventilation,
l'effet de mouvements d'air sur le confort estival
La
ventilation nocturne estivale
Rafraîchissement
par évaporation
Rafraîchissement
par tubes enterrés, puits canadiens
Applet JAVA: modèle 1 noeud
Bibliographie
Le confort estival- principes généraux
Dans la plupart des climats, il est possible par
une architecture sensible et des moyens passifs, d'assurer un climat
intérieur confortable en saison intermédiaire et estivale.
Ces mesures passives ne sont pas une alternative
à la climatisation, mais une condition préalable.
Un système de rafraîchissement actif (climatisation)
doit être envisagé seulement lorsque toutes les stratégies
passives ont été exploitées et optimisées.
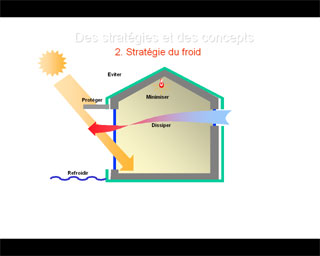
Généralement, il est nécessaire
de faire appel à différentes stratégies complémentaires,
une seule ne suffisant pas à garantir un confort suffisant.
Les 3 stratégies de base sont: protéger,
dissiper, stocker.
a) Minimiser les apports de chaleur, protéger:
Protections solaires
Gestion des apports internes
b) Optimiser les possibilités de dissipation
de chaleur:
Aération
Ventilation nocturne estivale
Rafraïchissement par évaporation
c) La masse thermique joue un rôle important
dès que l'on cherche à stocker et déstocker
du froid / chaud avec des décalages temporels:
Masse du bâtiment
Masse thermique du terrain
Protection solaire
Une excellente protection solaire est la base d'un
bâtiment confortable en période estivale.

Office building "iGuzzini" | Recanati
(I) | Mario Cucinella Architects | 1996-99
Selon l'exposition des façades et des ouvertures
et de leur orientation, des systèmes de protection différenciés
doivent être envisagés:


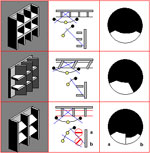
Protection verticale, latérale, combinée
Source images © DIAS 2.11, d'après
'Design with climate - Bioclimatic approach to architectural regionalism',
Victor Olgyay, 1963, New Jersey
On différencie 3 types de protections en foction
de leur position par rapport au vitrage: Par ordre décroissant
d'efficacité
Protections extérieures fixes ou mobiles
Systèmes entre verres et films ou verres antisolaires
Protections intérieures et rideaux
Protections extérieures
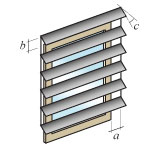
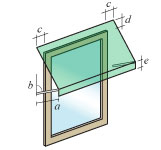 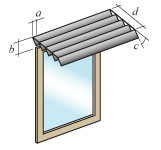
Source images protection extérieure
© Parasol-LHT
Les protections extérieures sont efficaces car elles évitent
un échauffement du verre. Lors de dispositifs fixes, un dessin
en fonction de la géométrie solaire est essentiel.
Dans cette catégorie tombent aussi avant-toits, balcons,
pergolas...
Les volets roulants, en tissu ou à lamelles sont également
efficaces mais plus fragiles en raison de leur mécanisme
et les sollicitations dûs au vent.
Une automatisation s'avère intéressante
pour assurer un fonctionnement optimal du dispositif. Elle contribue
également à un bon vieillissement en relevant les
protections extérieures en cas de vents forts. Les capteurs
sont à placer avec soin et le système doit laisser
la possibilité aux usagers d'interagir.
Dans le cas d'un bâtiment climatisé,
une automatisation est indispensable en raison du découplage
climatique des occupants.
Ces protections sont la seule solution permettant de protéger
efficacement du rayonnement solaire.
Protections intermédiaires
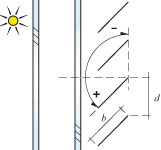
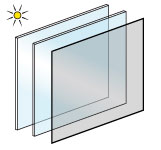
Source images © Parasol-LHT
Selon les propriétés optiques des verres et la couleur
des lamelles, les protections solaires par persiennes entre verres
sont peu à inefficaces en raison de l'échauffement
de la fenêtre (température du verre pouvant atteindre
plus de 50°C). Ces solutions peuvent aussi poser des problèmes
de maintenance en raison de l'inaccessibilité du mécanisme
entre les verres.
Le respect des valeurs g maximum (voir définition ci-dessous)
autorisés par la norme est difficile à atteindre.

Source image verre antisolaire ©
Parasol-LHT
Les films antisolaires sont une solution provisoire et leur efficacité
peut fortement varier d'un verre à un autre. L'altération
de couleur et la diminution de lumière naturelle sont problématiques
et le vieillissement, notamment sur des vitrages inclinés,
est rapide.
Les verres antisolaires peuvent être performants, à
condition de disposer de grandes surfaces car la réduction
de lumière visible et l'altération de couleur sont
sensibles.
Le respect des valeurs g maximum autorisé par la norme (voir
ci-dessous) est difficile, voire impossibleà atteindre.
Protections intérieures
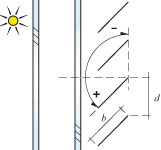
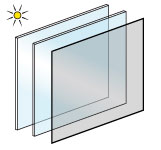
Source images © Parasol-LHT
En raison de l'absorbtivité des vitrages,
des rideaux et persinennes à l'intérieur de la fenêtre
sont très peu efficaces. Leur rôle est d'avantage en
rapport avec la régulation de la lumière naturelle
et la privacité des coccupants.
Définition de la valeur g
La valeur g définit le rapport entre l'énergie
solaire incidente à l'extérieur de la fenêtre
et la quantité d'énergie disponible derrière
la fenêtre. C'est la grandeur essentielle à prendre
en considération lors de la conception des fenêtres
et de leur dispositif de protection.
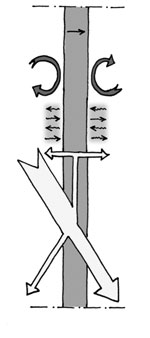 |
Dans la
définition du g, toutes les formes de transfert d'énergie
sont pris en compte:
- par rayonnement visible (lumière)
- par rayonnement infrarouge (chaleur)
- par conduction
- par convection
Le dispositif de protection
solaire fait partie intégrante de ce processus de transfert
de chaleur par réflexions multiples, échauffements
mutuels, échanges thermiques radiatifs... De cette
complexité découle une grande ignorance des
véritables performances des protections solaires, d'autant
plus que la valeur g dépend dans une certaine mesure
de l'angle d'incidence du rayonnement, de la températures
de l'air... et il est très difficile de déterminer
cette valeur, pourtant fondamentale, sans recours à
la mesure in situ (à l'aide d'un calorimètre
solaire).
Des valeurs typiques sont:
- Corps noir parfait: g = 1.00
- Simple vitrage: g = 0.85
- Double vitrage sélectif: g
= 0.65
- Double vitrage avec protection solaire
extérieure: g = 0.15
- Mirroir parfait: g = 0.00
|
Ce que dit la norme
La norme SIA 180 et SIA 382/1 definissent des exigences
afin de limiter les risques de surchauffe estivale: la valeur g
des fenêtres y compris le système de protection admissible
doit être inférieur ou égal à 0.15 [-].
La nouvelle norme 382/1 (prévue
2005) préconise une valeur g différenciée en
fonction de l'orientation de la fenêtre et du rapport
de vitrage (surface façade/surface fenêtre).
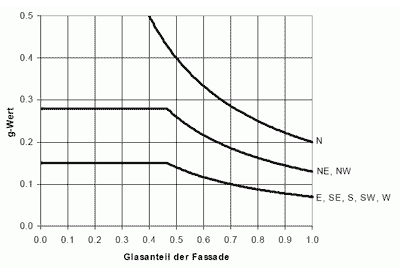
Source: Vernehmlassungsentwurf Norm SIA 382/1, Figure 2.1: 'Anforderungen
an den g-Wert von Verglasung und Sonnenschutz je nach Orientierung'
Géométrie solaire
L'effet de protection peut se trouver en contradiction
avec des exigences de vue et d'éclairage naturel.
Une bonne connaissance de la géométrie
solaire, des effets géométriques et de réflexion
est nécessaire car elle permet de déterminer les heures
critiques et de dimensionner avantageusement un système de
protection.
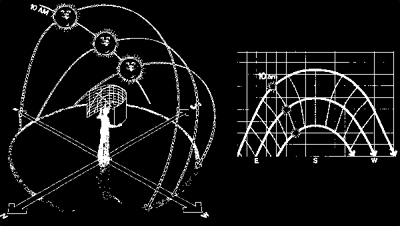
Source: Mazria, Edward, "The Passive
Solar Energy Book, A Complete Guide to Passive Solar Home, Greenhouse
and Building Design", Rodale Press; (May 1979)
Lien URL: Géométrie
solaire http://www.unige.ch/cuepe/enercad/geo_solaire.htm
Lien URL: logiciel Parasol-LHT >>> http://www.byggark.lth.se/shade/parasol.htm
Lien TOOL: Outil ombrage dans logiciel PEM et/ou EnerCAD
Apports internes

Office building "Powergen" | Coventry
(UK) | Bennetts Associates, London | 1993-94
Les apport internes ont des origines diverses:
Occupants (100 W/personne)
Eclairages
Appareils électriques
Les apports internes sont diminués dans des
pièces bénéficiant d'un bon éclairage
naturel et équipés de luminaires efficaces à
haut rendement et d'appareils économes en énergie,
le cas échéant, équipés d'une extraction
à la source de la chaleur produite.
Inertie thermique, l'effet de la masse du bâtiment

Queens building, De Montfort University |
Leicester (UK) | Short Ford & Associates Architects | 1993
La masse thermique n'est utile que s'il y a fluctuation
de température. Elle permet alors d'accumuler de la chaleur
et de retarder l'échauffement des pièces. En contrepartie,
il faudra évacuer la chaleur emmagasinée, par exemple
par une possibilité de ventilation nocturne.
La masse thermique doit être accessible, c'est
à dire en contact direct avec l'air ambiant. Faux plafonds
et double-planchers agissent comme isolants et découplent
l'air intérieur de la masse thermique. Dans le cas des faux
plafonds, il est important de laisser suffisament d'espace afin
de permettre une circulation de l'air dans le vide de plafond.
Une construction très massive restera fraîche
pendant plusieurs jours de canicule, à condition de bien
gérer les apports de chaleur (protections solaires, gains
internes).
La tendance actelle est à la construction
légère, en bois ou en ossature métallique.
Ces bâtiments disposent de par leur système constructif
d'une faible masse thermique et nécessitent d'excellentes
protections solaires ansi qu'une aération efficace.
Des matériaux à changement de phase
(p.ex. de la parafine encapsulée) permet de stocker d'importantes
quantiés de chaleur sans grand changement de température
(passage de la phase solide à la phase liquide). Ces solutions
sont en mesure d'absorber des 'pointes' thermiques. Cependant, l'énergie
emmagasinée doit pouvoir être évacuée
par la suite.
Ventilation, l'effet de mouvements d'air sur le
confort estival
Quoi de plus agréable qu'une légère
brise en période chaude: par transpiration, l'organisme favorise
l'évaporation d'eau sur l'épiderme permettant de lutter
très efficacement contre la chaleur. Une tenue vestimentaire
adaptée est un condition préalable essentielle. La
possibilité d'un brassage de l'air ou d'une ventilation naturelle
ciblée contribuent à ce phénomène. Toutefois,
des courants d'air excessifs sont à éviter (> 0.5
m/s).
Des typologies traversantes privilégient l'aération
naturelle par ouverture des fenêtres. Des grilles de ventilation
ou blocages de portes et d'autres ouvrants sont nécessaires.
La ventilation nocturne estivale

BRE Office Building | Watford (UK) | Feilden
Clegg architects
Le principe de la ventilation nocturne se base sur
le constat d'une température de l'air extérieure fraîche
pendant la nuit, plus efficace en zone périurbaine que dans
les centre-villes où l'abaissment nocturne de température
est moins sensible. L'air frais de la nuit sert à refroidir
le bâtiment en évacuant la chaleur emmagasinée
pendant la journée. Cette fraîcheur est ensuite disponible
pendant la journée. Le contrôle se fait par ventilation
du bâtiment dès que la température extérieure
est inférieure à la température intérieure.
Afin de bénéficier au mieux de ce phénomène,
le bâtiment doit disposer d'une bonne masse thermique. Pendant
la journée, quand la température extérieure
dépasse la température intérieure, il convient
de réduire le taux de ventilation par la fermeture des fenêtres
ou ouvrants et par la réduction du débit d'une éventuelle
ventilation mécanique au minimum nécessaire pour les
besoins d'hygiène (15m³/personne/heure, voir norme SIA
180).
Des problèmes éventuels à prendre
en considération sont:
intempéries
courants d'air
effraction
incendie
bruit
manipulation
Afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement
de ce principe, ces points sont à traiter avec attention:
possibilité de laisser des ouvertures de ventilation (fenêtres
ou clapets) ouverts en cas d'orage
les courants d'air doivent rester raisonnables (< 1 m/s)
les ouvertures ne doivent pas pouvoir donner lieu à des
visites indésirables
les ouvertures doivent être conformes aux exigences de sécurité
incendie
les problèmes éventuels de bruits urbains sont à
prendre en considération
la manipulation peut s'avérer lourde. L'automatisation est
une solution, à condition de laisser aux occupants la possibilité
d'interagir.
Rafraîchissement par évaporation
En s'évaporant, l'eau prélève
de la chaleur à l'environnement. Ce phénomène
est appelé refroidissement adiabatique.
L'effet de rafraïchissement par évaporation
le plus commun est celui des plantes. Le recours à la végétalisation,
notamment des espaces extérieures, est très efficace
et apporte un surplus d'oxygène bienvenu et de l'ombre.
Par ailleurs, des solutions de pluvérisation,
d'humidification et de ruissellements sont utilisés depuis
l'antiquité. Ces systèmes apportent de la fraïcheur
dans des climats chauds et secs.
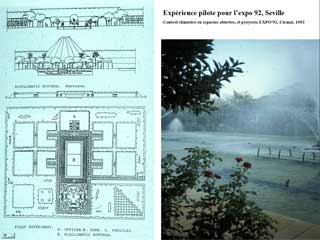
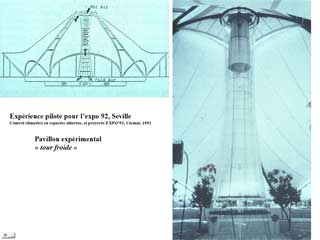
A gauche: Control climatico en espacios abiertos,
el proyecto EXPO’92, Ciemat, 1992
A droite: Pavillon expérimental « Rotonde bioclimatique
» : ''tour froide''
Rafraîchissement par tubes enterrés,
puits canadiens
Le recours à des tubes enterrés permet
de tirer profit de la masse thermique du terrain pour tempérer
l'air soufflé dans le bâtiment. Les meilleurs résultats
sont obtenus en refroidissant les tubes pendant la nuit par une
ventilation nocturne.
>>> schéma
puits canadien
Tools
Applet Java: modèle didactique 1 noeud
... à développer >>> développement
: PG + THO
>>> SIMBAT:
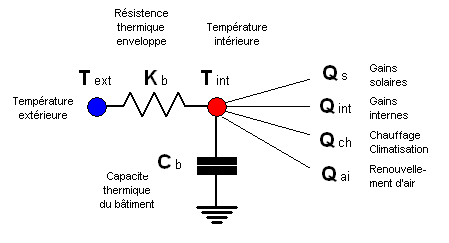
INPUT:
Météo horaire sur une année (T ext et Rayonnement
solaire) : fixe (p.ex. Genève ou Lugano)
Dimensions de la pièce et ouvertures : fixe (shoebox)
Valeur U murs
Valeur U verre
Valeur g verre
Capacité thermique (matériaux
et couplage thermique)
Apports internes
Renouvellement d'air avec stratégie
jour/nuit
OUTPUT:
Graphique une journée hiver
Graphique une journée été
Graphique Ti et Te annuel
Graphique heures classées confort
Bibliographie
Victor Olgyay, 'Design with climate - Bioclimatic approach to architectural
regionalism', New Jersey , 1963
Mazria, Edward, 'The Passive Solar Energy Book, A
Complete Guide to Passive Solar Home, Greenhouse and Building Design',
Rodale Press, 1979
Logiciel DIAS 2.11, 'Données interactives
d'architecture solaire', CUEPE, Université de Genève,
1996
Logiciel P.E.M., 'Pascool Electronic Metahandbook',
CUEPE, Université de Genève, 1996
Norme SIA 382/1, 'Performances techniques requises pour les installations
de ventilation et de climatisation'
Norme SIA 180, 'Isolation thermique des bâtiments', 1999
Norme SIA 380.078, prEN ISO 13363-1, 'Dispositifs de protection
solaire combinés à des vitrages', 2002
Cahier technique SIA 2021, 'Bâtiments vitrés, confort
et efficience énergétique', 2003-2004
Soleil
et architecture, guide pratique pour le projet (pdf), Cours
PACER, 1991
http://www.unige.ch/cuepe/enercad/geo_solaire.htm
Géométrie solaire
http://www.buildingenvelopes.org/
http://www.iea-shc.org/
http://www.wbdg.org
|
![]()